
Assistantes virtuelles : comment rédiger vos CGV ?
par Nathalie Lechay | 12 septembre 2025

Vos Conditions Générales de Vente (CGV) sont la clé de vos relations commerciales.
Elles fixent un cadre clair, sécurisent vos encaissements et réduisent les problèmes lors d’un désaccord.
Sans elles, chaque mission est risquée.
Avec elles, vous conservez la main : les règles sont posées, vos limites sont visibles et vos délais de paiement deviennent prévisibles.
En pratique, vos CGV doivent être accessibles en permanence depuis votre site (lien en bas de page) et tenues prêtes au format PDF pour être partagées.
Elles doivent refléter vos usages réels : inutile de lister des clauses théoriques que vous n’appliquez jamais.
Visez la lisibilité et l’opposabilité : des phrases courtes, un vocabulaire concret, des points de contrôle précis (échéances, modalités de validation, périmètre des livrables).

Ce que vos CGV doivent couvrir sans ambiguïté
Commencez par définir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas.
Une assistante virtuelle intervient souvent sur des prestations dites « intellectuelles » : gestion d’agenda, coordination, suivi administratif, production documentaire, support client, création de modèles, automatisations, organisation d’événements à distance, assistance commerciale.
Fixez un périmètre réaliste et explicitez les prérequis côté client : accès aux outils, disponibilité pour les validations, transmission des éléments nécessaires.
Si une mission dépend d’une information fournie par le client, dites-le clairement.
Expliquez comment une commande devient ferme.
La plupart des indépendantes sécurisent par un devis signé et un acompte. Indiquez la forme acceptée pour la validation (signature électronique, bon pour accord par e-mail), le calendrier indicatif et la date de démarrage.
Si vous intervenez à la carte, précisez le minimum d’heures facturables par intervention et l’éventuel délai de prévenance si nécessaire.
Parlez argent sans détour.
Annoncez votre méthode de tarification (horaire, forfait, abonnement), la base de calcul, les éventuels frais annexes (déplacements quand il y en a, licences logicielles spécifiques, envois postaux), les conditions de révision de vos tarifs sur les contrats au long cours.
Plus votre méthode est explicite, moins vous aurez à arbitrer au cas par cas.
Cadrez la validation des livrables.
Dites comment vous livrez (format, canal), sous quel délai vous attendez un retour, et ce que vous considérez comme une acceptation tacite.
Introduisez un process simple : un document est réputé conforme si, à l’issue d’un laps de temps convenu, aucun retour précis n’a été formulé.
Prévoyez une boucle d’ajustement courte et bornée (par exemple un aller/retour inclus, puis facturation au temps passé).
Protégez votre création.
Par défaut, ce que vous produisez vous appartient. Vous pouvez concéder une licence d’utilisation au client, adaptée à ses besoins, et réserver la cession complète aux cas où elle est nécessaire.
Encadrez précisément ce transfert : droits cédés, durée, territoire, destination, moment d’effet (après paiement intégral). Cette précision évite les récupérations et les exigences illimitées.
Rassurez sur la confidentialité et le traitement des données.
Engagez-vous à la discrétion, précisez vos mesures de sécurité (gestionnaire de mots de passe, double authentification, cloisonnement des accès), listez à titre indicatif les principaux outils utilisés, et décrivez la procédure de sortie de mission : révocation des accès, restitution ou purge des données non nécessaires, réversibilité.
Prévoyez les situations « difficiles ».
Donnez-vous la faculté de suspendre la prestation en cas d’impayé, d’absence de retours, d’accès manquants ou de manquements répétés du client à ses obligations.
Encadrez la résiliation avec un préavis raisonnable pour les abonnements et la conservation des sommes dues pour le travail déjà réalisé.
Terminez par le traitement des litiges.
Si vous travaillez uniquement avec des professionnels, indiquez le droit applicable et la juridiction compétente.
Si vous vendez aussi à des particuliers, incluez les informations sur le droit de rétractation, le médiateur de la consommation que vous avez désigné, et la procédure d’accès à ce recours amiable.
Les conditions de règlement, pénalités et indemnité
Votre trésorerie dépend de la précision de cette partie.
Posez un délai de paiement clair. Rappelez que les pénalités de retard courent automatiquement dès le lendemain de l’échéance. Mentionnez l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par un client professionnel en cas de retard. Répétez ces informations sur chaque facture.
L’objectif n’est pas de « punir », mais d’installer une vos règles dès la première mission.
Clause-exemple : paiement, pénalités, indemnité
« Sauf stipulation contraire au devis, les factures sont exigibles à 30 jours à compter de leur date d’émission. Tout retard de paiement entraîne, sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard au taux légal en vigueur, exigibles le lendemain de l’échéance, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par tout client professionnel. Des frais complémentaires peuvent être réclamés sur justificatifs si les frais réels de recouvrement excèdent ce montant. En cas d’impayé, l’exécution des prestations pourra être suspendue jusqu’au complet paiement. »
Pour les formules récurrentes, pensez au prélèvement automatique ou au paiement par lien sécurisé ou virement à date fixe.
Pour les projets de plus grande ampleur, demandez un acompte au démarrage.
Conseil : Évitez les délais au-delà de ce que vos charges peuvent absorber.
Propriété intellectuelle, confidentialité et données : protéger sans enfermer
La plupart des litiges viennent d’attentes implicites.
Évitez-les en encadrant la propriété des livrables. Le réflexe le plus protecteur consiste à accorder une licence d’utilisation non exclusive et non transférable pour l’usage interne du client, et à réserver la cession intégrale aux cas justifiés (par exemple des gabarits de marque destinés à une diffusion large).
Précisez une règle claire : la licence comme la cession prennent effet après paiement complet. Décrivez en quelques lignes ce que la licence n’autorise pas (revente telle quelle, cession à un tiers, utilisation en dehors du projet).
Côté confidentialité, engagez-vous à préserver les informations confidentielles du client et exigez en retour le même engagement sur vos méthodes, outils et contenus.
Indiquez des mesures concrètes : gestionnaire de mots de passe, segmentation des accès par projet, double authentification sur les comptes sensibles, traçabilité des accès.
Sur la fin de mission, annoncez la marche à suivre : restitution des documents, révocation des accès, durée de conservation résiduelle si nécessaire, puis purge.
Clause-exemple : propriété intellectuelle et données
« Sauf stipulation contraire, les éléments produits par la prestataire (documents, procédures, modèles, visuels) restent sa propriété. Le client bénéficie, après paiement complet, d’une licence d’utilisation non exclusive et non transférable, limitée à ses besoins internes. Toute cession de droits fera l’objet d’un avenant précisant le périmètre, la durée, le territoire et la rémunération. Chaque partie s’engage à la confidentialité des informations de l’autre. La prestataire met en œuvre des mesures raisonnables de sécurité (gestionnaire de mots de passe, double authentification, cloisonnement des accès). En fin de mission, les accès sont révoqués et les données non nécessaires sont supprimées selon la politique interne de conservation. »
Résiliation, suspension et force majeure : prévoir l’exception pour protéger le quotidien
Aucune collaboration n’est à l’abri d’un imprévu.
Précisez les cas de suspension : impayé, absence de retours, défaut d’accès ou de collaboration active. Encadrez la résiliation pour manquement grave avec un délai laissé à la partie défaillante pour remédier au problème.
Pour les collaborations « long terme », prévoyez un préavis simple (par exemple un mois à date anniversaire).
Pour les projets en cours, rappelez que les sommes dues pour le travail réalisé et les frais engagés restent exigibles.
La force majeure mérite un paragraphe dédié. L’idée est de suspendre les obligations le temps de l’empêchement, puis de reprendre ou, si la situation se prolonge, de permettre à chaque partie de mettre fin au contrat sans pénalité.
Faites simple : une liste d’exemples suffit à l’illustration, sans transformer la clause en « catalogue ».
Clause-exemple : résiliation et force majeure
« En cas de manquement grave non résolu dans un délai de 15 jours suivant une notification écrite, chaque partie peut résilier de plein droit le contrat. Les prestations réalisées et frais engagés restent dus. Les collaborations long terme sont résiliables avec un préavis d’un mois à date anniversaire. Aucune partie n’est responsable d’un manquement dû à un événement de force majeure. Les obligations sont suspendues pendant la durée de l’événement ; si celui-ci excède 60 jours, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans indemnité. »
CGV, devis et contrat : un ensemble cohérent, facile à appliquer
Considérez vos CGV comme le cadre commun.
Le devis et le contrat de mission portent les conditions particulières négociées pour un projet précis : périmètre, planning, prix, livrables.
Si une clause du devis ou du contrat contredit vos CGV, c’est le devis ou le contrat qui s’applique, à condition que l’intention dérogatoire soit explicite.
Ajoutez une politique de confidentialité distincte si vous traitez des données sensibles ou si vos clients l’exigent.
Évitez la redondance : un document = un rôle.
Plus vos documents sont nets, plus ils sont compris et respectés.
Mise en œuvre : où, quand et comment publier
Placez vos CGV sur une page dédiée, accessible depuis le pied de page de votre site, avec un PDF à jour et daté.
Répétez les informations clés sur les devis et sur chaque facture : échéance, pénalités, indemnité, modalités de paiement.
Conservez la preuve de tout (devis signé, cases cochées, horodatages, versions successives des CGV) : cette discipline documentaire règle bien des discussions.
Structure type à reprendre pour vos CGV
Pour vous aidez, vous pouvez reprendre la structure ci-dessous et l’adapter à votre activité, en conservant le style et les clauses.
- Objet et périmètre : mission, limites, prérequis, obligations réciproques.
- Commande et démarrage : devis ou bon pour accord, acompte, calendrier indicatif, disponibilité client.
- Prix et facturation : base de calcul, frais annexes éventuels, révision, étapes.
- Conditions de règlement : échéance, pénalités de retard, indemnité forfaitaire, suspension en cas d’impayé.
- Livrables et validation : formats, délais de retour, recette, retouches incluses.
- Propriété intellectuelle : licence par défaut, cession encadrée, transfert après paiement intégral.
- Confidentialité et données : sécurité, sous-traitance, révocation des accès, purge en fin de mission.
- Rétractation et médiation (si B2C) : modalités, formulaire, démarrage anticipé, médiateur et coordonnées.
- Responsabilités et assurances : plafonds, exclusions justifiées, assurance responsabilité civile professionnelle.
- Résiliation, suspension, force majeure : préavis, frais engagés, sortie de mission, empêchements majeurs.
- Droit applicable et règlement des litiges : juridiction compétente entre professionnels, recours amiable le cas échéant.
Erreurs fréquentes à éviter
✘ Utiliser des CGV génériques déconnectées de vos pratiques crée des contradictions au premier désaccord.
✘ Laisser des zones floues sur le périmètre ouvre la porte aux demandes illimitées.
✘ Céder immédiatement tous les droits de propriété vous prive d’un levier de valorisation.
✘ Oublier la répétition des mentions clés sur les factures affaiblit vos relances.
✘ Négliger la preuve documentaire complique toute discussion.
✘ Enfin, ignorer la procédure de sortie de mission rend la réversibilité laborieuse et entame la confiance.
En conclusion...
Je ne suis pas juriste : rien ne remplace l’avis d’un avocat ou d’un professionnel du droit pour valider vos CGV.
Mon rôle, en tant que formatrice qui élève le niveau du métier, est de vous donner un cadre pratique et exigeant.
Ici, je parle en professionnelle, pas comme si l’activité d’AV était un hobby ou un job d’appoint.
Des CGV claires changent votre quotidien : vous êtes payée plus vite, vous évitez les problèmes inutiles et l’image de sérieux auprès de vos clients monte d’un cran.
Prenez du temps pour rédiger vos CGV, adaptez les encadrés proposés à vos offres, publiez-les au bon endroit et mettez vos devis/factures en cohérence.
Vous gagnerez en sérénité, en crédibilité et en pouvoir de négociation.
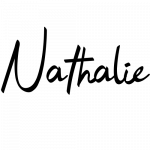
Cet article vous a éclairé sur le métier d’assistante virtuelle et vous souhaitez avoir des informations sur la formation Virtu’Elles Assist ?
Prenez rendez-vous, je vous recevrai personnellement pour en parler.
Une assistante virtuelle doit-elle obligatoirement avoir des CGV ?
Oui. Elles doivent être rédigées, publiées sur votre site et communiquées aux clients. Pour un acheteur professionnel, la communication s’effectue sur demande ; pour un consommateur, l’information est fournie avant l’engagement.
Faut-il rappeler les pénalités de retard et l’indemnité sur les factures ?
Oui. Mentionnez l’échéance, le taux des pénalités exigibles dès le lendemain de la date de paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par un client professionnel en cas de retard.
Comment encadrer la validation d’un livrable ?
Prévoyez un délai de retour raisonnable et une recette simple. Sans retour précis dans ce délai, le livrable est réputé conforme. Ajoutez une passe de retouches incluse, puis facturation au temps passé.
Puis-je démarrer une prestation pour un particulier avant la fin des quatorze jours ?
Oui, si la personne le demande expressément et reconnaît les effets sur son droit de rétractation. En cas d’exécution totale pendant ce délai, la rétractation n’est plus ouverte ; en cas d’exécution partielle, une facturation proportionnelle s’applique.


